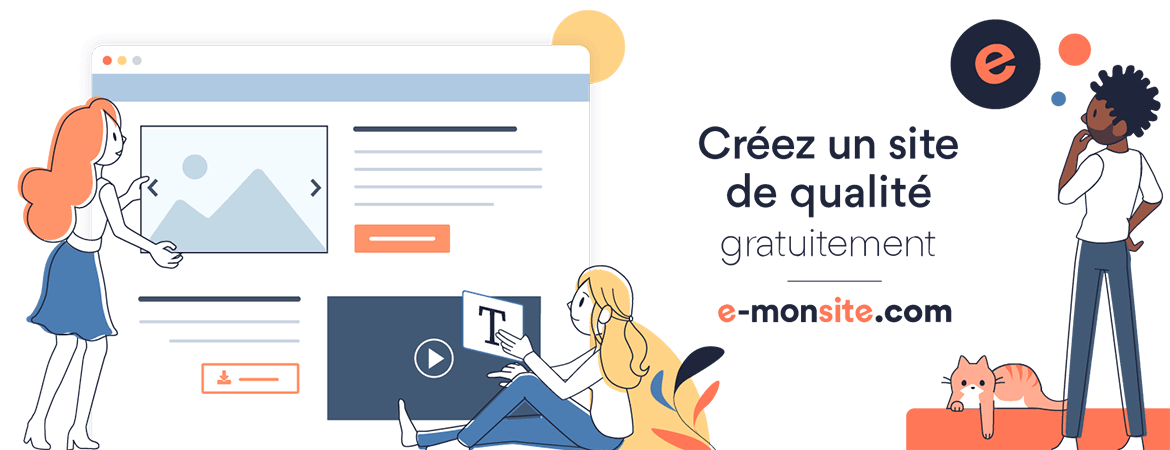Sociologie de la Famille
Document de travail
A. ANCELIN SCHUTZENBERGER, Aïe mes Aïeux ! Edts Desclée de Brouwer, 1993.
ATTIAS DONFUT C., les solidarités entre générations : vieillesse, famille, état, Edts Nathan, Paris, 1995.
E. BADINTER, L’un et l’autre, Edts Jabob, Coll. Livre de poche, Paris, 1986.
DECHAUX J.H., Dynamique de la famille : entre individualisme et appartenance in GALLAND O. , LEMEL Y., La nouvelle société française, Edts Colin, Coll. U, Paris , 2001.
DE GAULEJAC, L’histoire en héritage, Edts Desclée de Brouwer, 1999.
FIZE M. La démocratie familiale ; Evolution des relations parents adolescents, Edts Presse de la renaissance, Paris, 1990.
FIZE M., a mort la famille, Plaidoyer pour l’enfant, Edts Eros, sociologie de la vie quotidienne, Paris, 2000.
GIRARD A., Le choix du conjoint,
GODARD F. , La famille, affaire de générations, PUF, Paris, 1992.
HERITIER F., L’exercice de la parenté, Edts Gallimard, Paris, 1981.
KAUFFMAN J.P., La trame conjugale, Analyse du couple par son linge, Edts Nathan, Paris, 1992.
KAUFFMAN J.P. , sociologie du couple, que sais-je ?, PUF, 1993.
KELLERHALS J. MONTANDON C., les stratégies éducatives des familles, Edts Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1991.
KELLERHALS J. , TROUTOT , LAZEGA , Microsociologie de la famille, que sais-je ?; PUF, Paris, 1984
LEGENDRE P. L’inestimable objet de la transmission, Edts Fayard, Paris, 1985.
MARTIN , L’après divorce. Lien social et vulnérabilité, PU de Rennes, Rennes, 1997.
MICHEL A. , Sociologie de la famille et du mariage, PUF, Paris, 1986.
PITROU A. Les solidarités familiales : vivre sans famille ?, Edts Privat, Toulouse, 1992.
ROUSSEL, La famille incertaine, Edts Jacob, Paris, 1989
SEGALEN M. , sociologie de la famille, Edts Nathan, Paris, 1996.
SINGLY ( DE) F., Le soi, le couple et la famille, edts Nathan, Paris, 1996.
THERY I. Le démariage. Justice et vie privée ; Edts Jacob, Paris, 1993.
THERY I., DHAVERNAS, La parenté aux frontières de l’amitié : statut et rôle du beau parent dans les familles recomposées, in MEULDERS – KLEIN, THERY, Les recompositions familiales aujourd’hui, Essai de recherche, Edts Nathan, Paris, 1993.
COURS DE SOCIOLOGIE DE
CHAPITRE 1 : L’alliance
I. La famille : une affaire de groupe
L’alliance inscrit la lignée dans la durée, favorisant l’exercice d’une continuité, la constitution d’un enracinement qui caractérise la dimension de l’héritage.
Paramètre important : se repérer dans sa généalogie.
Pour quelle raison est-ce si important ?
La généalogie est nécessaire à la constitution de l’ordre social :
- elle introduit l’ordre de la temporalité (avec la chronologie)
- elle introduit l’ordre de la nomination (par le langage)
- elle introduit l’ordre de la raison (par la proposition de référents, de catégories de classements qui permettent de construire des points de repères et du sens).
- elle introduit l’ordre symbolique (par la proposition de règles, de lois, d’interdits qui sont au fondement du droit qui permettent d’éviter le chaos).
- elle introduit l’ordre social (il instaure la hiérarchie entre les générations, qui est au fondement de l’échange, de la socialisation et de la culture).
Dans cet ordre social sera transmis ce que A. ANCELIN nomme « la carte des comptes familiaux ».
A. ANCELIN dresse la carte des comptes familiaux et sociaux permettant de repérer :
- les dettes
- les obligations
- les mérites de chacun.
Lorsqu’il n’y a pas de situation d’équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu par chacun, entre les dettes (dons) et les mérites (reçus) pour chacun apparaîtraient des symptômes plus ou moins graves (exemple : déresponsabilisation). Symptômes qui va constituer un déterminant de l’histoire familiale, qui va donc se transmettre de Générations en Générations.
Ainsi, elle précise que le déséquilibre dans la balance des comptes de la famille serait la cause des problèmes répétitifs que l’on se voit transmettre de générations en générations.
- en termes d’habitus sociaux
- Comme système de référence global : qui marque la situation d’appartenance et inscrit le maintien des « traditions familiales ».
- En confrontation permanente avec des systèmes différents de références (systèmes qui traversent les individus selon les situations d’interaction diverses qu’ils rencontrent) susceptibles de générer des situations de conflits :
√ Conflit intériorisé
√ Conflits familiaux
Avec de fortes contraintes psycho-relationnelles.
C’est par le jeu des appartenances et des prises d’autonomie que la famille en tant que groupe se structure, se transforme, et tente désormais de s’inscrire dans une perpétuelle négociation, avec des répercussions importantes sur la situation d’équilibre :
- lorsqu’il y a brouillage des repères
- lorsqu’il y a difficulté à mettre du sens sur les actions familiales, ainsi que sur les positionnements du groupe familial.
Comme une des explications possibles à l’observation du délitement des liens familiaux.
II. La famille : une affaire de couple
L’alliance est au fondement de la constitution de nouveaux « foyers », construites à partir d’éléments rapportés.
En ce qui concerne ces éléments rapportés :
- L’alliance est une question strictement privée : sentiment pour les individus d’une grande liberté de choix. La distribution n’est pourtant pas dirigée par le hasard !
- proximité sociale : homogamie
Alliance continuent à se faire dans une grande proximité aux niveaux des appartenances sociales. Corrélation élevée du niveau intellectuel (par test de QI).
Une explication à ce résultat : les situations d’inter connaissances répondent à des logiques.
- les lieux de rencontre sont souvent des lieux de fréquentation (loisirs, études…). Dit moi les lieux que tu fréquentes, je te dirais qui tu rencontreras. % important de couples signifiant qu’ils ont des amis en commun. Les circonstances de rencontre sont loin d’être aléatoires !
L’alliance est donc très largement d »terminée par les usages sociaux du temps libre. Ainsi, la société du temps libre permet que continue à s’exercer les forces sociales inconscientes qui prédisposent l’homogamie sociale.
- proximité culturelle
- Les images parentales : A. STRAUSS conclut à une ressemblance des caractères physiques de la femme avec ceux de la mère du conjoint. MANGUS : les filles conservent une empreinte beaucoup plus durable de la part de leur père que les garçons de la part de leur mère.
Une explication à ce résultat : les filles reçoivent davantage une éducation tournée vers l’intérieur. Autrement dit, la sociabilité féminine s’inscrit plus largement au sein de la cellule familiale où s’exercent encore des modèles de masculinité et de féminité.
Lien possible avec les apports de psychologie :
La mère est dans l’intériorité du lien à l’enfant.
Le père représente celui qui introduit le « tiers ». Il est le garant de l’extériorité, d’une sociabilité plus large.
Les individus tendent à faire alliance avec un conjoint qui partage sur quelques points fondamentaux :
- les mêmes genres de vie
- les mêmes ordres de conduite
Ainsi, les sociologues parlent de la situation d’homogamie comme étant le corollaire de la conscience de groupe. Comme si les pulsions personnelles étaient soumises à des règles sociales.
Lien possible avec les apports de la psychologie :
Et notamment avec la deuxième topique de FREUD : « le moi, le ça, le surmoi »
III. Précarisation de la vie en couple ou pas ?
Certains constats démographiques nous amènent à parler d’un « effritement de la vie en couple ».
- La progression des divorces marque une instabilité (notamment par consentement mutuel depuis 1975).
- L’éventualité de la séparation est désormais inscrite dans le mariage lui-même.
- L’union favorise les essais de vie en couple et les changements de partenaires :
- avec d’un côté l’offre d’une garantie aux futurs mariés
- avec de l’autre la légitimité du changement de partenaires.
Ces éléments font de l’instabilité du couple une donnée normale de la vie familiale.
- le mariage a perdu son caractère de rite de passage : on parle de « déritualisation ».
- on assiste donc par ailleurs à la privatisation du lien conjugal : correspond au refus de soumettre sa vie privée à la loi et au contrôle social : cette privatisation du lien conjugal correspond à une période que de DE SINGLY nomme le « temps du démariage ».
Ainsi l’instabilité du couple serait le symptôme d’un mouvement de désinstitutionalisation. Ainsi, ce sont les trajectoires conjugales, plus que le couple lui-même, qui ont connu les plus grandes modifications.
Même si les couples cohabitants finissent de moins en moins par se marier, leur mode de vie n’est pas très différent des personnes mariées. La vie en couple demeure la référence centrale même pour ceux qui vivent seuls.
Selon F. BATTAGLIOLA, les femmes se seraient emparées du concubinage comme un moyen :
- de préserver leur position dans les rapports entre les sexes
- de refuser le statut que leur assigne dans ces rapports le mariage et la maternité.
Les couples continuent à reproduire le même schéma sexué dans la répartition des attitudes et des comportements familiaux.
Ainsi, non seulement ces couples ne menacent en rien l’ordre social, mais ils contribuent à le reproduire.
- dans la routine qu’ils mettent en place. Il s organisent des rôles, et définissent pour chacun des territoires dans l’univers ménager et domestique. Ils vont prendre en charge la plupart des tâches domestiques, en dépit de leur idéal égalitaire : la vie commune réaffirme un ordre sexuel décrivant la force des normes et des habitudes incorporées.
Affection et norme ne s’excluent nullement.
C’est la qualité des relations interpersonnelles qui se transforme. DE SINGLY parle de « spychologisation » du lien familial avec un désir d’authenticité des liens.
Remarque : le désir de personnalisation des liens engendre paradoxalement leur encadrement progressif dans des rôles et des normes pré existantes.
Question que l’on se pose désormais : peut –on réduire le fonctionnement du couple à une individualisation croissante ?
Première remarque : nombreux sont les sociologues qui affirment qu’opposer modernité et tradition, c’est séparer ce qui constitue les 2 faces d’une même réalité : individuation et appartenance, autonomie et dépendance. Ces notions ne sont pas plus modernes les unes que les autres.
Le lien familial serait de toute manière régi par la dialectique de l’autonomie et de la dépendance : l’individualisme familial n’évacue pas tout désir d’appartenance. L’objectif des individus serait de tenter d’accéder à cet équilibre complexe.
IV. Vers de nouveaux liens conjugaux
Les relations de couple sont en pleine mutation :
- modèle du mariage d’intérêt : devoir chrétien de s’aimer par ce qu’on était marié.
- modèle de l’amour romantique : l’amour dans le mariage qui correspond au rêve de se marier parce qu’on s’aimait. C’est la construction d’une destinée sentimentale comme réalisation de soi. Ces femmes faisaient alors de l’amour le but de toute leur existence. Modèle correspondant à l’image du prince charmant : l’homme parfait qui nous comprend mieux que nous même : facteur de révélation de soi, faisant figure d’idéal.
- le modèle de l’amour romantique laisse place à une nouvelle conception de la vie à 2 : l’amour fissionnel : le mariage par l’amour.
IL est définit comme celui qui permet de conjuguer :
- affirmation de soi
- sentiment amoureux
Ce passage d’un modèle à l’autre constitue une véritable mutation, s’accompagnant de la déconstruction des anciens repères, vers la reconstruction de nouveaux repères.
Cette mutation serait du à 2 principaux éléments :
- le changement du statut de l’individu
- conjugué à la métamorphose des relations affectives.
Ces éléments marquent les nouveaux fondements de la relation.
La variation de l’expression des sentiments amoureux a des conséquences sur la structuration du couple.
Quelles sont les conséquences énoncées ?
La principale conséquence énoncée est la révision du contrat de couple qui lie la femme à son conjoint.
- s’étant consacrée « corps et âme » à son mari et à ses enfants, cette femme née dans les années 50 prend conscience que cette vie était un don de soi.
Ne regrettant pas nécessairement cette expérience, elle entend à présent affirmer ses envies et ses désirs.
Après s’être préoccupée des autres, elle décide de vivre par elle-même. Cette idée simple signifie 2 choses :
- les femmes de cette génération n’entendent pas se sacrifier pour la vie
- la famille était jusque là un renoncement.
Dans la confrontation des générations :
- si les mères revendiquent leur émancipation après avoir fait les frais d’un modèle aliénant pour leur personnalité
- leurs filles sont plus rétives à y entrer et plaident pour une transformation des relations dès le départ.
Ainsi,
- si les premières divorcent (suite à l’accentuation des rôles sociaux inégalitaires atténuant la vision romantique).
- les secondes entendent changer le lien lui-même pour ne pas y sacrifier une part de leur existence.
Cette mutation du lien entre les conjoints participe du processus historique d’individuation et bouleverse par là même l’expression de la relation amoureuse.
L’individu s’est émancipé :
- de la communauté
- de la parentèle
- des unions imposées affirmant son libre choix jusqu’à la fusion romantique.
Le trompe l’œil de la fusion romantique
Le modèle de la fusion romantique n’est envisageable que si l’un des 2 partenaires accepte de disparaître dans l’opération. La subjectivité de l’un doit se réduire à celle de l’autre pour que l’idéal fonctionne.
Or, historiquement, ce sont les femmes qui étaient élevées pour disparaître.
Les sociologues comme G. FALCONNET, N. LEFAUCHEUR, parlent de sacrifice dissimulé (qui aurait succédé au sacrifice affirmé).
Les femmes prennent alors peu à peu conscience que l’idéal de partage est un trompe l’œil qui cache une situation inégalitaire.
Elles seront alors de plus en plus nombreuses à demander le divorce pour recommencer leur vie.
Un nouveau type de relation amoureuse émerge alors, allant vers une « déromantisation » des relations. La mise en couple fait de plus en plus de place à l’affirmation des 2 individualités.
- les individus (hommes, femmes) veulent être « sujets » de leur histoire
- les femmes veulent exister par elle-même.
Il s’agit pour elle de composer désormais un couple où l’autonomie sera de mise.
Le couple doit désormais apprendre de nouveaux partages qui permettent à chacun d’exister sans se nier : c’est le « post-romantisme ».
Le post-romantisme lance un défi : l’alliance ne doit plus être synonyme de confusion de destins.
Lien avec la psychologie :
Cannibalisme de FREUD : « cannibalisme métaphysique » synonyme du désir d’engloutir l’autre, de se l’approprier pour mieux le posséder.
Remarque : La déconstruction de l’amour romantique ne signifie pas le renoncement à toute forme d’amour.
La relation est désormais une réunion de 2 vies qui ouvre sur une tierce histoire, celle du couple.
Les 3 récits disposent de leur autonomie CAD apprendre à exister ensemble et séparément. « Etre libres ensemble » selon la formule de DE SINGLY.
Ces éléments marquent la recherche d’indépendance. Une recherche nécessaire selon G. SIMMEL qui se demandait déjà à son époque ( ? ) : si on ne s’appartenait pas davantage qualitativement en s’appartenant moins quantitativement.
La période actuelle marque un dépassement des enfermements. Ce dépassement selon Ilan COHEN amène le recouvrement des notions de masculin / féminin : corollaire de l’envie d’aborder tous les rôles selon les désirs en présence.
Vers la mise en exergue d’un nouveau mode de vie : l’union des célibataires. CAD vivre avec ou sans l’autre dans une forme de couple qui puisse garantir l’indépendance et la sauvegarde de son autonomie : volonté de changer d’identité à volonté.
Les nouveaux liens marquent désormais des relations où l’identité peut être sans cesse redéfinie au gré des rencontres et des circonstances.